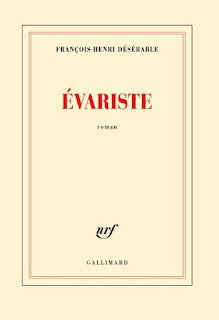Le seul roman écrit par Ionesco. A trente-cinq ans, un homme fait un héritage et se retire de la vie. Il ne cesse de s'étonner de ses congénères qui continuent à s'agiter, à se battre même, à aimer, à croire. La recherche de l'oubli, la nostalgie du savoir que nous n'aurons jamais, le sentiment de notre infirmité et du miracle de toute chose, font de cet individu banal un être qui a la grâce, un mystique pas tellement loin de Pascal.
Miettes:
Je m’ennuyais bien un peu. Nous savons tous que rien n’est plus triste qu’un dimanche après-midi. Les jeunes couples avec la maman enceinte qui poussait la voiturette d’un bébé, tandis que le jeune papa avançait en en tenant un autre par la main, me donnaient l’envie de les tuer ou de me suicider. Mais à partir du troisième ou quatrième demi de bière, tout devenait comique et même gai.
***
Ai-je jamais senti qu’un feu ardent couvât sous les cendres ? Ah la la… J’ai beau interroger mon âme, j’ai beau l’explorer, je n’y décèle aucune vibration profonde. Dans les espaces gris de l’intérieur, il n’y a que des décombres, sous d’autres décombres, sous d’autres décombres. Mais s’il y a des décombres, il y a eu peut-être un temple autrefois, des colonnes lumineuses, un autel ardent ? Ce n’est qu’une supposition. En fait il n’y a jamais eu rien d’autre, peut-être, que le chaos.
***
Et pourtant je me sentais mal à l’aise dans ma peau. Ne sachant pas comment bouger pour que je ne la sente pas ou que je la sente le moins possible. De temps à autre, surtout dans mon adolescence, le mystère universel m’avait troublé. Un univers infini n’est pas concevable par notre entendement. Et pourtant on m’avait répété à l’école et partout que l’univers était infini. Et puis on m’avait dit que l’univers était fini et non pas infini, cela me semblait encore moins concevable, si l’on peut dire, car qu’est-ce qu’il y avait « après » ? Il est probable que l’univers n’est ni fini ni infini, les mots fini ou infini étant des expressions qui ne veulent rien dire. Si on ne peut s’imaginer le fini ni l’infini, ni le ni-fini ni-infini qui sont des choses si élémentaires, si simples, qu’on aurait dû être fait pour pouvoir concevoir, que pouvions-nous faire d’autre que de ne pas penser ? Toute notre raison chavire dans le chaos. Que pouvons-nous savoir de la justice, de l’ordre physique, de l’histoire, des lois de la nature, du monde, si les bases fondamentales de notre entendement possible nous sont inconnues à nous-mêmes ? Surtout, ne pensons pas. Ne pensons à rien. Ne jugeons de rien.
***
En fait, je suis né accablé. L’univers me semblait être une sorte de grande cage ou plutôt une sorte de grande prison, le ciel, l’horizon me semblaient être des murs au-delà desquels il devait y avoir autre chose, mais quoi ? J’étais dans un immense espace, enfermé cependant. Ou plutôt cela me semblait être une sorte de grand bateau à l’intérieur duquel je me trouvais et dont le ciel était quelque chose comme un grand couvercle. Nous étions des multitudes de prisonniers. Il me semblait que la plus grande partie de ces prisonniers n’avait pas conscience de l’être.
***
Ne pas avoir la puissance de concevoir l’univers, de savoir comment est ce qui est, cela n’est pas admissible. Sans compter que nous savons que la forme des choses n’est que l’image que nous nous faisons d’elles… Depuis l’âge de douze ans cette question m’habitait périodiquement et me donnait le même sentiment d’horrible impossibilité, la nausée. Comment font tous ces gens qui se promènent dans les rues ou qui courent après leurs autobus ? Si tout le monde se mettait à penser ça ou plutôt à imaginer cela qui est inimaginable, ils ne bougeraient plus du tout. Je m’étais déjà dit : ne pensons pas puisque nous ne pouvons pas penser. Les gens négligent ou oublient l’impensable, c’est à partir de l’impensable qu’ils pensent, ils fondent leurs pensées sur cet impensable et cela encore est pour moi impensable. Et pourtant, ils ont inventé l’arithmétique, la géométrie et des algèbres… mais les algèbres aussi vous ramènent au gouffre… mais ils ont construit des machines, ils ont organisé des sociétés, ils s’en fichent pas mal de la question absolue, la question sans réponse.
***
Il y a une sagesse qui nous enseigne à nous réjouir des petites choses que peut nous donner l’existence. J’avais vécu longtemps en utilisant ce principe. Puis j’avais appris à ne pas être trop accablé, ni par les petites ni par les choses plus grandes que nous offre l’existence. Mais elle n’est pas facile à supporter la quotidienneté, enfin, tout de même, l’oisiveté devait être préférable au travail. Entre l’effort et l’ennui, c’est toujours un certain ennui que je choisissais, que je préférais.
***
Je n’ai rien d’intéressant à dire aux autres. Et ce que disent les autres, cela ne m’intéresse pas non plus. La présence des autres m’a toujours gêné. Il y avait une sorte de cloison invisible entre eux et moi. Pas toujours.
***
Il faut se résigner pour ne pas souffrir. Il faut se résigner. Je me dis tout le temps qu’il faut se résigner. Très souvent, je réussis à me résigner à peu près. Ce n’est pas une résignation profonde, réelle. De temps en temps la rage pointe. C’est d’abord un certain mécontentement qui grandit en moi, qui m’envahit, qui m’étreint. Non, jamais je ne me consolerai, jamais je ne pourrai oublier, ne pas voir derrière ce mur, qui monte jusqu’au ciel. Comment se résigner à l’ignorance dans laquelle nous sommes plongés malgré les sciences, malgré les théologies, malgré les sagesses ? Depuis ma naissance je n’ai rien appris et je sais que je n’apprendrai rien. Ce sont les bornes de l’imagination que je voudrais enlever. Les murs de l’imagination que je voudrais faire sauter. Jamais ils ne s’écrouleront et je mourrai aussi ignorant qu’à ma naissance. C’est inconcevable de ne pas pouvoir concevoir l’inconcevable.
***
Mais alors, sur quelles bases pouvons-nous fonder un savoir ou une morale ? En aucun cas, cette base ne peut être l’ignorance et nous ne sommes que dans l’ignorance, nous n’avons comme base de départ, comme fondement, que le néant. Comment bâtir sur le rien ? Nous avons quelques expériences pratiques à notre disposition. Je sais que je peux me déplacer. Je sais que je peux aller au restaurant. Je sais qu’on a fait des restaurants. Je sais qu’il y a des engins. Je sais qu’il y a une technique. Il me semble très étrange de m’apercevoir qu’il y a tout de même indiscutablement une technique qui tient, comme ça, sur rien du tout. Cela est encore un autre niveau de mon étonnement. Qui nous le permet ou comment cela est-il permis, comment cela peut-il se faire ? Mais encore et encore une fois et toujours, un savoir limité n’est pas un savoir. L’univers entier et tous les êtres, nous sommes manœuvrés par des instincts, par des réflexions possibles à courte portée que l’on a mis en nous. Nous sommes agis, nous n’agissons pas. Je crois que je mange pour moi. Je mange à cause de l’instinct de conservation. Je crois que j’aime et que je fais l’amour pour moi, ce n’est que pour perpétuer l’espèce, ce n’est que pour obéir à des lois qui me le commandent.
***
Après mon septième apéritif, je pensais qu’il n’y a ni réel, ni irréel, ni vérité, ni mensonge. Toutes les philosophies et toutes les théologies sont bonnes ou mauvaises si on veut ou si on ne veut pas. Cela me fit rire.
***
Évidemment, répondis-je, vous connaissez ces problèmes, vous avez lu, vous avez du savoir, mais ces questions me secouent, elles sont vivantes pour moi. Pour vous, ces problèmes ne sont que de la culture. Vous ne vous réveillez pas tous les jours dans l’angoisse à vous demander quelles sont les réponses, à vous dire qu’il n’y a pas de réponses. Mais vous savez que tout le monde s’est posé ces questions. Vous savez qu’on n’y a jamais répondu, et qu’on ne peut y répondre. Seulement, chez vous, tout cela est catalogué. Puisque vous savez que ces problèmes sont posés, puisque vous savez qui les a posés, puisque vous savez qu’il y a tant de traités et de livres qui ont abordé ces sujets, vous ne vous les posez plus, vous avez mis ça de côté, quelque part dans votre mémoire. Mais oui, pour vous ce n’est que de la culture. On a cultivé le désespoir, on en a fait de la littérature, des œuvres d’art. Cela ne m’aide pas. C’est de la culture, de la culture. Tant mieux pour vous si la culture a pu conjurer le drame de l’homme, la tragédie.
***
Comme si le monde pouvait être habituel ! Comme si le monde pouvait être normal ! Comme si sentir ses battements de cœur et respirer était naturel ! Je regardais un objet se trouvant devant moi, un mètre soixante-dix de haut, un mètre vingt de large, avec deux battants de porte que l’on pouvait ouvrir. À l’intérieur, il y avait des planches où des vêtements, les miens, étaient accrochés, et du linge, le mien, rangé sur des planches. Évidemment, si on m’avait demandé ce qu’était cet objet, j’aurais répondu que c’était une armoire. Mais cela n’était plus une armoire, je ne pouvais croire sincèrement que ce fût une armoire, ce n’était pourtant pas autre chose. À tout le monde, j’aurais pu répondre que c’était une armoire. Pourtant les mots mentaient. Non seulement les objets n’étaient plus les mêmes objets, mais les mots n’étaient plus les mêmes mots. Les mots me paraissaient faux. Les objets avaient perdu, me semblait-il, leur fonction.